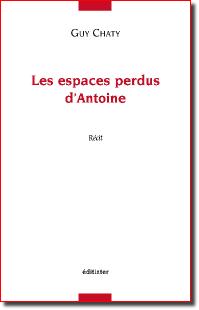 | ||
Le narrateur marche sur les pas de l'enfant qu'il fut, cherche à retrouver les « espaces perdus » en évoquant des sensations, des souvenirs lointains, des épisodes d'une histoire individuelle qui coïncide parfois avec l'Histoire. Tout en contant l'apprentissage d'une vie, l'ouvrage restitue la vie rurale dans un petit village de France, au milieu du vingtième siècle, et la vie de paysans transplantés, devenus ouvriers, dans une ville de la région parisienne, avec ses pavillons de banlieue et ses jardins, qui permettent de conserver une certaine ruralité. | ||
REVUE DE PRESSE • Jean-Paul Giraux, dans la revue Brèves n°79 Les écrivains ont toujours des problèmes à régler avec leur double. Antoine est celui de Guy Chaty qu’il nous invite à regarder vivre dans ses souvenirs les plus lointains. Il a quel âge, Antoine, pendant l’exode avec sa famille, dans ce village inconnu du Loir et Cher ? Alors, il a peur de tout. De M. Lanin, le fermier, du chien, des cochons et des Allemands avec leurs gâteaux empoisonnés. Est-il héroïque ou gourmand, allez savoir ? Il se risque... D’ailleurs, les Allemands ne sont pas si méchants : la preuve, ils chantent tout le temps. Il faudra attendre quatre ans pour qu’ils déchantent. En attendant, c’est le retour en région parisienne, l’école, les restrictions, les bombardements. L’arrivée des Américains. Enfin ! Tout ce temps pour que la vie se découvre dans le triangle que dessinent pour Anatole l’église, l’école, la maison : on apprend à se servir des patins de la salle à manger, qu’à l’école il faut lever le doigt pour avoir le droit de parler, que les enfants naissent dans le ventre de leur mère, qu’il y a des choses qui font bien plaisir mais qui sont de graves péchés, que dans la hiérarchie des choses désagréables, les piqûres (celles qu’on vous inflige pour votre bien) précèdent la piscine et la gymnastique, que l’autobus est toujours complet qui doit vous amener à l’heure au collège. Bien d’autres choses encore. Et puis voilà qu’Anatole a grandi. Ce double sympathique que l’auteur a observé avec une indulgence amusée et quelque distance – il dit « il » en parlant de lui – va s’effacer, sans jamais tout à fait disparaître, au profit d’un jeune homme de seize ans dont le « je » affirmé est mûr pour affronter les aléas d’une vie d’adulte : l’amour, la mort, le métier. La chrysalide et le papillon ! Aujourd’hui, Anatole ressurgit dans ce court récit, drôle et nostalgique, où l’Histoire s’inscrit en filigrane, un témoignage en quelque sorte, à travers ce qui reste – dans la réalité et dans les souvenirs – d’une enfance partagée entre trois espaces – les espaces perdus d’Antoine : village des origines familiales, village de l’exode, ville ouvrière de la région parisienne – dont les années ont nécessairement ébréché les contours. • Bernard Fournier, dans la revue Poésie première, n°37 Raconter son enfance demeure une tentation pour chacun parce que le récit nous dédouble : l’enfant se montre à travers les yeux de l’adulte et c’est cette mise en abyme qui rend l’écriture difficile et patiente. Guy Chaty a acquis quelque notoriété par des nouvelles sur fond d’humour, maniant avec dextérité une langue subtile et ingénieuse. Dans Anatole et son chat (Editinter 1998), il prenait le biais du surréalisme pour débusquer l’être morcelé qui vivait en lui. Entre Anatole et Antoine, l’auteur a su retrouver, par le déplacement des lettres, un personnage mi-réel mi-rêvé qui convient parfaitement au bon usage de la nostalgie. Si l’on y prend garde, Anatole fait aussi référence à Anatole France et son Crime de Sylvestre Bonnard qui semble avoir été un des premiers révélateurs de la littérature pour le jeune garçon. La double entrée dans ces récits se révèle alors triple, incluant le recul nécessaire et obligé de la littérature. Dans ces deux registres, de la nouvelle humoristique et du conte surréaliste, l’auteur se révèle un poète des plus sensibles qui soit. Ces récits en prose témoignent d’une époque par petites touches, petites scènes quasi cinématographiques qui font revivre autant l’époque de la guerre et de l’immédiat après-guerre que l’éveil d’un garçon à l’adolescence. « Pourquoi faire coïncider les espaces cachés des premières consciences avec la réalité physique d’où ils sont sortis, puis avec ce qu’ils sont devenus ? Vaine entreprise ». Guy Chaty manie donc le souvenir avec beaucoup de tact et de recul pour mieux appréhender le réel dans toutes ses dimensions authentiques et oniriques. Ce qui importe, c’est celui qui écrit, au moment où il écrit : « le narrateur, passeur d’espaces », « nés d’un lieu et d’une conscience enfantine […] ils ne seront vraiment perdus qu’avec elle ». « Passeur d’espaces », ainsi se nomme le poète plutôt que passeur de temps : les deux sont bien sûr liés mais l’accent apporté à la géographie nous indique que pour la conscience, la réalité est première, bien avant la conscience du temps.
• Jacques Morin, dans la revue Décharge n°131 Il y avait déjà "Anatole", personnage quasi lunaire à la Michaux côté poésie, à sa suite on retiendra, Antoine côté récit, Antoine, c'est Guy Chaty enfant : jusqu'à 16 ans précisément, âge où il prend conscience qu'il existe en tant que "je" et le narrateur de changer de personne. Récit donc largement autobiographique, à travers l'occupation, les divers apprentissages de la vie, les épreuves familiales… Je n'ai pas le même âge que Guy Chaty mais je me suis retrouvé dans son expérience de banlieue, il parle des "6 routes" de Bobigny, je répondrais par les "4 routes" de Drancy, un peu plus loin venant de Pantin sur la ligne d'autobus, titre d'un chapitre. Lisière de la ville et vacances au petit village dans l'Est. Les "espaces perdus", ce sont tous les lieux dans lesquels on a vécu, soit qui ont disparu depuis lors, soit qui ont été transformés et de ce fait sont devenus méconnaissables, soit encore qui n'ont pas bougé mais qui ne correspondent plus à la conscience de l'adulte, lequel n'appréhende plus les choses de la même façon et se sent forcément déçu de ne pas les retrouver identiques à son souvenir, ce qui avec le temps se révèle finalement impossible. Ce récit montre bien un autre aspect de Guy Chaty humoriste que nous connaissions jusqu'à présent, fort et riche de son expérience humaine irremplaçable. Le souvenir, bien stocké dans la mémoire, voisine la corbeille bien ventrue de l'oubli. • Philippe Biget, sur le site apa, Nous avons lu, vu, surfé… octobre 2006 Comment gérer la relation avec l’enfant que nous avons été ? Question lancinante et vieille comme le monde, et je suis conscient du prosaïsme déplacé du verbe gérer que je viens d’employer. Car appréhender ce rapport étrange (entre intime proximité et distance déconcertante) requiert la mobilisation de toutes les facettes de l’esprit humain. Avoir été et ne plus être implique une rupture, douloureuse peut-être, mais salutaire pour qui veut aller au plus loin sur le chemin du devenir. Pour faire face à ce défi, Guy Chaty a choisi la voie de l’extrême lucidité, de l’observation quasi clinique du phénomène. Afin de mieux y parvenir, il baptise l’enfant Antoine, officialisant d’emblée la dichotomie qu’il revendique, et qui n’exclut pas la tendresse du regard porté sur cet autre. Le récit alerte nous relate les épisodes les plus initiatiques de la vie d’un enfant découvrant le monde et l’humanité dans la France profonde du milieu du Xxème siècle. Un éveil accéléré par la guerre, bien sûr, et les bouleversements domestiques qu’elle provoque. L’auteur se glisse dans la peau d’Antoine, c’est à dire dans un mode d’observation souvent déconcertant pour un adulte, et tente de ne rien nous cacher des rapports ambivalents entretenus avec la religion, des circonstances parfois scabreuses de la découverte du plaisir, des deuils, du sentiment amoureux, etc. Et puis, un jour : Le temps a passé. J’ai seize ans. Je me réveille (…) L’enfant Antoine ne me quittera plus, dissimulé de plus en plus derrière ce je en éclosion, mais se dévoilant parfois, surgissant même, lorsqu’il se sentira trop bousculé. La volonté de repousser au plus loin les limites du souvenir, tout en restant conscient des risques d’erreur que cela implique, pourrait donner au récit un ton trop aride, mais l’émotion n’est jamais totalement refoulée par l’esprit scientifique car Guy Chaty, tout en se présentant comme un simple narrateur, passeur d’espaces, continue de materner Antoine. Si j’ose employer ce mot, c’est qu’il le fait lui-même quand, revisitant un lieu qui fut le théâtre d’un amour de jeunesse, il écrit : Quand je la vois au loin, aujourd’hui comme hier, elle fait bouger en moi un désir d’amour, comme un enfant remue dans le sein de sa mère. Un livre attachant qui incitera le lecteur à parcourir différemment les espaces de sa propre enfance | ||
Guy Chaty
LES ESPAVES PERDUS D'ANTOINE
Récit
15,30 EUR
ISBN 2-915228-91-4
104 p. ; 21,5 x 13,5 cm
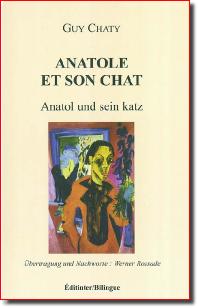
Guy Chaty
ANATOLE ET SON CHAT
Poésie Bilingue
Traduit du français par et postface Werner Rossade
ISBN 2-915228-48-5
104 p. ; 21,5 x 14 cm ; 13,20 EUR
REVUE DE PRESSE
• Jacques Morin, critique dans la revue Décharge, n°124, décembre 2004
C'est un recueil qui avait fait l'objet d'un n° spécial de la revue IHV en 1998 et que je n'avais pas lu à l'époque, sa réédition chez Editinter agrémentée d'une traduction en allemand par Werner Rossade me donne l'occasion de rattraper la chose. Anatole est un parent du Plume de Michaux, personnage léger, malléable et fantasque. Il lui arrive toutes sortes d'aventures invraisemblables et loufoques. Il a à la fois un chat dans la gorge pour de vrai et un vrai chat planté dans un manche qui fait office de balai. A l'intérieur, son corps est vacant, creux, ou bien cassant, cassable, il n'est pas rare qu'il se brise quelque chose, tout ou partie, qu'il se disloque, perdant deux dents qui flottent dans l'air, une main qui s'envole, oiseau migrateur, un estomac vomi, comme une poche amovible, voire une tête, pour dialoguer. Dehors, tout ce qu'il fait s'apparente peu ou prou à la démarche scientifique, on est toujours dans l'expérience ou l'expérimentation, lesquelles n'ont pas souvent de sens ou bien si l'on peut en découvrir un, ce sera la conclusion qui se révèlera absurde. On ne peut être que charmé par ce personnage attachant qui vit dans un monde imaginaire entre humour et fantaisie. Anatole possède aussi un chien dominateur.
• Philippe Biget, critique dans la revue Friches printemps 2005
Qui est Anatole ? une créature complexe que l’auteur donne l’impression de manipuler à sa guise (mais n’est-ce pas réciproque ?), un peu à la manière d’un clown dissimulant l’émotion ou la perplexité sous le burlesque. Une sorte de Monsieur Plume, et la référence à Henri Michaux vient souvent à l’esprit même si Guy Chaty a su donner à son livre une touche très personnelle conférée par un mélange de situations incongrues, aberrantes, parfois cruelles et d’une tendresse enfouie, comme tapie à l’écart ou plutôt à l’intérieur, et dont la vigilance semble surprendre l’intéressé.
Et le chat, direz-vous ? Il n’apparaît qu’à deux reprises au long de ces trente-sept proses poétiques et ironiques. Animal discret et souple mais ô combien symptomatique de l’ambivalence d’Anatole et de l’interaction entre lui et son autre moi. C’est ainsi qu’Anatole s’aperçoit de l’existence d’un chat enfermé dans sa propre tête : miaulements, gratouilles, vibrations, que faire ? Anatole va dans la cuisine, doucement pour ne pas fâcher la bête. Il boit du lait dans un bol blanc : aussitôt, le chat se calme.
Nous sommes loin d’un humour au premier degré, et cela se confirme de texte en texte, sans lassitude aucune au point qu’une relecture fera percevoir de nouvelles nuances. Parmi les nombreux thèmes abordés, j’ai été surpris de découvrir l’humilité dans le rapport à son propre corps, curieux mélange de stoïcisme et de sagesse orientale.
• Jacques Lucchesi, revue Alexandre, septembre 1998.
[Ce] personnage idéalement naïf s'inscrit dans une tradition séculaire et pluri-culturelle. En 37 courtes proses poétiques, Chaty a signé un recueil que l'on ne risque pas d'abandonner en cours de lecture, tellement son humour et sa tendresse nous entraînent sans effort de page en page. Si Anatole est un peu idiot, c'est pour mieux nous chuchoter que le monde n'est pas aussi simple que notre mesquine façon de l'utiliser; que nous aurions intérêt à nous arrêter davantage devant tout ce que nous croyons connaître.
• Alain Hélissen, revue Sapriphage, N°34, Automne 1998.
Les aventures d'Anatole sont sans doute trop incroyables pour être vraies mais leur lecture nous laisse comme au sortir de cauchemars, dans cet état intermédiaire entre la réalité extérieure et les dernières agitations de fantasmes venus on ne sait d'où. Anatole et son chat ne font rien pour percer le mystère. Un mystère qui ressemble quelque peu à celui de la création littéraire.
• Gil Refloch, revue Quimper en poésie, N°24, octobre 1998.
En 37 tableaux en prose dont certains sont de véritables petits joyaux d'écriture, Guy Chaty, par petites touches impressionnistes, brosse pour notre seul plaisir l'âpre apprentissage de la vie d'Anatole en société. Regard insolite, exigeant du lecteur qu'il se positionne à plusieurs degrés différents de lecture.


ÉDITINTER ÉDITIONS